Vignobles de France
La Champagne redécouvre ses cépages anciens
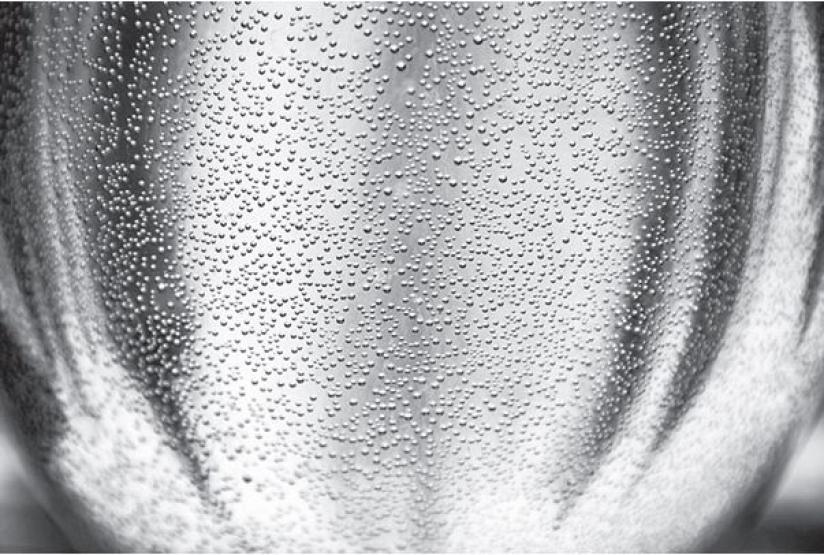
Extraits de l’article paru dans le numéro 150
Pinot blanc, petit meslier, arbane et fromenteau demeurent tout à fait mino ritaires (à peine 0,4 % de la superficie plantée en Champagne à eux quatre), mais au sein de l’appellation d’origine Cham pagne (et Coteaux-champenois, par ail leurs) ils ont de fait toujours été autorisés de manière officielle qui, d’ailleurs, ne citait que les « diverses variétés de pinot, l’arbanne, le petit meslier », “oubliant” ainsi le chardonnay (sans doute assimilé au pinot)). Appréciés ou re doutés, ils représentent un témoignage tangible de la variété ampélographique d’antan et, en dépit d’une présence anec dotique, ils constituent un antidote à la standardisation imposée par le trio pinot noir-chardonnay-pinot meunier, qui a marqué (et un peu lissé) l’histoire mo derne du vignoble rémois, sparnacien et barséquanais. Nouvel engouement ? Cépages d’avenir ? Il serait sans doute téméraire de vouloir l’affirmer, maisons et vignerons semblent en effet prudents et mitigés à leur égard. Toujours est-il que, le réchauffement cli matique et une quête de biodiversité ai dant, la superficie plantée croît, très len tement, mais sûrement. À quoi s’ajoute l’inconnue d’un huitième mousquetaire : le voltis, créé de toutes pièces par la re cherche agronomique pour, dit-on, faire face au dérèglement global (voir encadré). Nous sommes allés à la rencontre de ces revenants de la Champagne.
Un héritage en partage
Gouais, gamay, épinette, morillon, beaunois, tourlon, marmot, françois noir et blanc... autant de plants qui peuplaient autrefois le vignoble champenois et qui ont disparu suite aux multiples péripéties, ravages et hasards de l’oïdium, du mildiou, du phylloxéra, des guerres, de l’agro-in dustrialisation, de l’exode rural, de la mécanisation, de la sélection clonale, etc. Quelques-uns de ces cépages ont sans doute succombé à l’extinction, d’autres noms devaient correspondre à des sous-va riétés (phénotypes ou écotypes locaux), d’autres encore n’étaient probablement que des synonymes du même raisin, dé nommé différemment d’un village à l’autre.
Il est toutefois admis qu’avant la nor malisation du XXe siècle, la Champagne devait disposer de dizaines, voire de quelques centaines de cépages, parfois peu, parfois très dissemblables les uns des autres. Il n’en reste quasiment rien de nos jours.
Dans un tel contexte de standardisa tion, dominé par le quasi-monopole des trois plants majeurs, et par quelques di zaines de leurs clones, la réapparition des quatre survivants est sans doute bienfai sante. Ils apportent un surcroît de biodi versité dans les vignes et d’expressivité dans les vins, une touche d’originalité, ainsi que des caractéristiques et des qua lités complémentaires. On peut donc s’en réjouir. Pourtant, il y a à peine quelques années, ces plants champenois n’étaient que tolérés, et leur emploi découragé.
