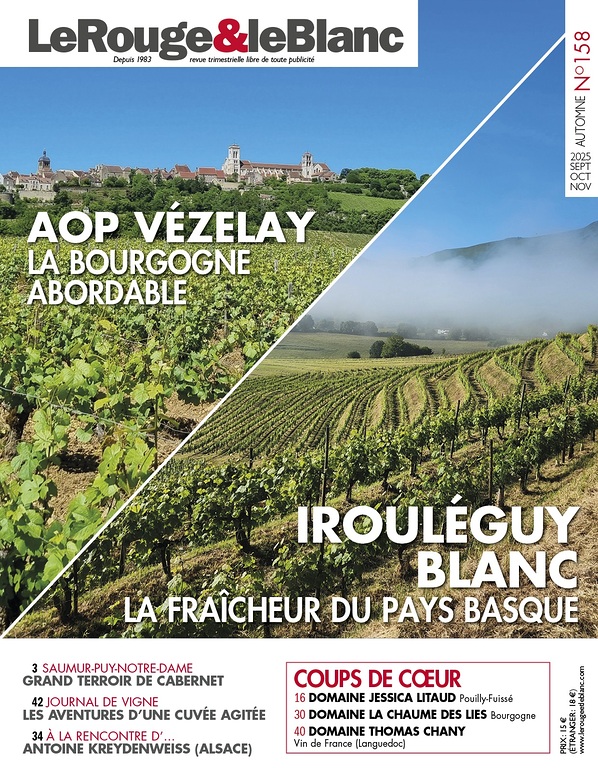Sous les cendres, la vigne
Cet été, les Corbières ont brûlé. Pas seulement quelques hectares, pas seulement une saison de plus sous le signe des canicules et des feux incontrôlables. 17 000 hectares ont été parcourus par les flammes, l’équivalent de quatre années cumulées d’incendies en France (2019, 2020, 2021 et 2024) et le double de 2023. Mais, outre la mort d’une femme, les personnes blessées, les maisons brûlées, les arbres calcinés, c’est un pan entier du vignoble qui a été ravagé, près de 1 000 hectares selon les premières estimations. Parmi les victimes, deux domaines mis en avant par notre revue (Cf. R&B n°143) : le Clos de l’Anhel de Sophie Guiraudon, ravagé à 90 %, envisage de cesser son activité, et le Domaine des Deux Clés de Gaëlle et Florian Richter dont la moitié des vignes a été anéantie, sans compter la destruction d’un hangar, et de leur outil de travail. Et pour les vignes qui ont été «épargnées» ? Vendanger des raisins imprégnés de fumée ? Distiller à perte, à 40 € l’hectolitre, sans même couvrir les frais de récolte ? La question se pose, cruelle.
La solidarité a été forte, comme souvent dans ces moments-là. Mais l’émotion ne doit pas masquer l’urgence d’agir. Ces incendies ne sont pas une fatalité. Ils sont le résultat direct d’un modèle agricole qui a tout saccagé : des décennies d’intensification, de monocultures, d’arrachages massifs et d’abandon des terres ont transformé des paysages autrefois cloisonnés en étendues de végétation sèches et inflammables. L’agriculture intensive a vidé les campagnes, chassé les paysans, transformé des coupe-feux naturels (vignes, haies, parcelles diversifiées) en friches géantes, et ouvert en grand les portes aux flammes qui sautent d’un massif à l’autre. Pendant ce temps, l’élevage extensif, qui aurait pu entretenir ces terres, régénérer les sols et limiter les risques, a été sacrifié sur l’autel du rendement et de la monoculture.
Et que fait-on ? On arrache des vignes sous prétexte que la consommation de vin baisse, une décroissance savamment entretenue par la loi Évin et les ligues hygiénistes. Une logique absurde car la vigne pourrait jouer un rôle clé, non pas en tant que culture intensive, mais comme élément d’un paysage équilibré. Même peu productives, les parcelles ralentissent l’avancée des flammes grâce à un entretien du sol qui supprime les débris végétaux et au positionnement de rangs éloignés les uns des autres. Alors pourquoi ne pas réinvestir les coteaux pour des vins de qualité, libérer les terres fertiles des plaines pour d’autres cultures (fruits, olives, amandes), et réintroduire des troupeaux pour débroussailler, fertiliser, structurer les paysages ?
Mais pour ça, il faudrait briser l’emprise de l’agro-industrie. Cesser de sacrifier nos paysages sur l’autel du rendement. La FNSEA et ses relais politiques nous ont imposé une loi Duplomb, une machine à broyer l’agriculture paysanne au profit des géants. Il est temps de repenser notre rapport à la terre, et au vin, qui n’est pas qu’un produit, mais un morceau de notre histoire et de notre culture. La vigne peut être une solution, pas un problème, à condition de la réintégrer dans un écosystème vivant, et non dans une logique de profit à court terme.
Car une chose est sûre : si rien ne change, ce ne sont pas seulement les Corbières qui brûleront, mais l’avenir même de nos territoires. La balle est dans le camp des pouvoirs publics (et des acteurs paysans). Et le temps presse.
LeRouge&leBlanc